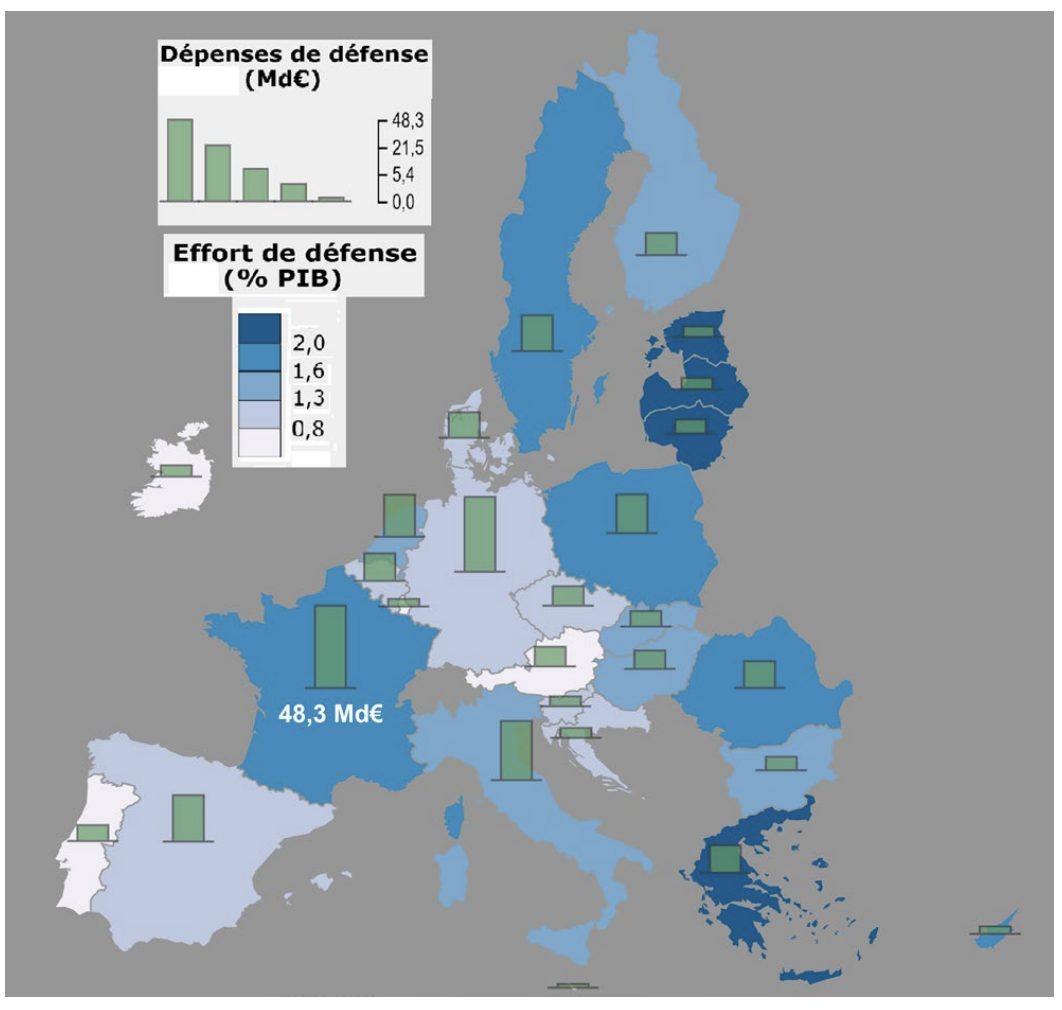Le retour d’une rivalité entre les États-Unis et la Chine, conjugué à la stagnation économique de l’Union européenne, a révélé une profonde division au sein du bloc. La Hongrie, en proie à un repli vers Pékin, reçoit des milliards d’investissements étrangers, tandis que la Slovaquie s’éloigne progressivement de Bruxelles sur les questions ukrainiennes, cherchant une alliance avec Moscou. Même dans les pays encore alignés sur l’UE, comme la Pologne et la Roumanie, des partis illibéraux menacent le consensus existant, démontrant que Bruxelles ne représente plus l’unique voie possible pour ces nations.
Ces tensions ne sont pas accidentelles mais le reflet d’un calcul géostratégique : l’économie mondiale se fragmente en raison de chaînes d’approvisionnement instables, des technologies disruptives et une rivalité accrue entre les puissances. Bruxelles, déterminée à renforcer sa souveraineté industrielle, s’oriente vers des secteurs stratégiques tels que l’énergie verte ou la fabrication locale de semi-conducteurs. Mais les pays d’Europe centrale et orientale, encore dépendants du marché extérieur et des capitaux étrangers, sont désavantagés dans cette course. Leur modèle économique ancien, basé sur l’exportation et le coût du travail, ne leur permet pas de s’adapter à ces nouvelles exigences, les poussant ainsi vers des partenariats alternatifs qui menacent l’unité européenne.
L’érosion interne de l’UE est exacerbée par la montée en puissance de la Chine et le recul des États-Unis, qui ont jusqu’à présent soutenu un ordre mondial libéral. La « démondialisation » a permis à Pékin d’accroître son influence, tandis que les crises géopolitiques (guerre en Ukraine, pandémie) ont perturbé les flux de matières premières et de technologies critiques. L’Allemagne, moteur des exportations européennes, connaît un ralentissement industriel qui aggrave la fragilité du système.
L’UE tente d’adopter une stratégie industrielle plus forte avec des réglementations comme le « Règlement européen sur les semi-conducteurs » et l’industrie zéro-net, mais ces mesures ne s’appliquent pas uniformément à tous les pays. Les petites économies de l’est, dépendantes d’un modèle basé sur la fabrication bon marché, sont marginalisées par cette dynamique. Leur incapacité à investir dans l’innovation et leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement étrangères les placent en position de faiblesse face aux bouleversements mondiaux.
L’absence de cohérence entre le centre et la périphérie a des conséquences politiques : l’Europe centrale et orientale, où les gouvernements illibéraux s’affirment, devient un terrain propice à des alliances alternatives. La Hongrie, par exemple, profite de son « ouverture vers l’Est » pour attirer des investissements chinois, tout en évitant d’être piégée dans les querelles internes de Bruxelles. Cette diplomatie a permis à Budapest de compenser le ralentissement allemand et d’accroître ses revenus et son emploi.
Cependant, cette autonomie stratégique n’est pas sans risques. Les pays comme la Slovaquie ou la Pologne, qui tentent de s’aligner avec l’UE sur des questions économiques, se heurtent à des contraintes imposées par le noyau occidental. Leur dépendance aux capitaux étrangers et leur incapacité à mener une politique industrielle autonome les rend vulnérables face aux pressions géopolitiques.
Au final, la crise de l’UE révèle une inégalité structurelle : les grandes économies comme l’Allemagne ou la France bénéficient des aides d’État et des investissements stratégiques, tandis que les petits pays restent en marge. Cette fragmentation menace non seulement l’équilibre économique mais aussi la cohésion politique du bloc. Une véritable autonomie européenne ne peut se construire sur un système à deux vitesses, où certains États dominent les décisions industrielles et géopolitiques, tandis que d’autres sont réduits à des plateformes de sous-traitance.
La solution passe par une intégration plus équitable : reconnaître la vulnérabilité des pays périphériques et leur offrir les outils nécessaires pour sortir de leur dépendance. Sans cela, l’UE risque de se désintégrer, avec l’Europe centrale et orientale abandonnée à des alliances alternatives qui menacent son unité.
Jan Boguslawski est chercheur doctorant à Sciences Po Paris et travaille sur l’économie politique et les transformations de l’État-providence en Europe centrale et orientale.