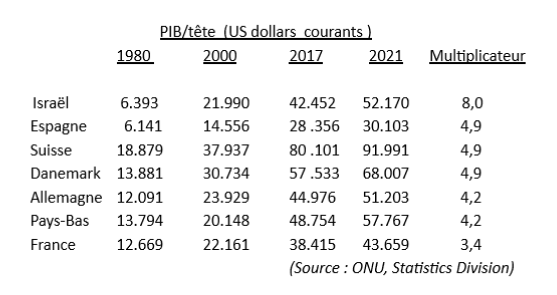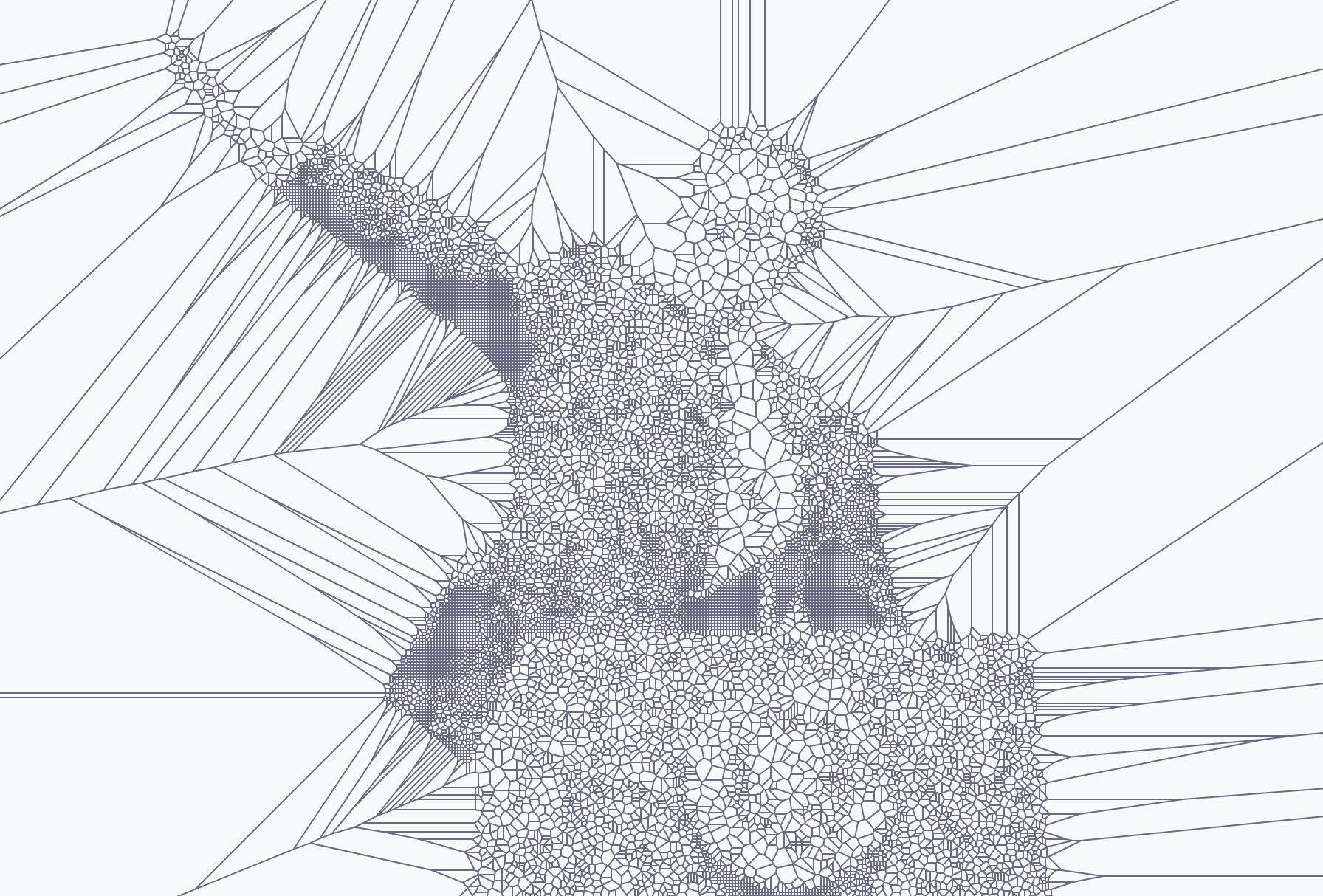Le récent sommet à la Maison Blanche, organisé par Donald Trump en marge du conflit entre Bakou et Erevan, a été présenté comme un pas vers la paix. Cependant, l’accord de paix signé ne cache qu’une victoire militaire écrasante d’Abou au détriment des intérêts arméniens. Les négociations ont révélé une profonde inégalité entre les deux pays, où la domination azerbaïdjanaise se traduit par un accord vide de substance et des conditions inacceptables pour l’Arménie.
Le texte commun publié après le sommet est à peine plus qu’un document symbolique. Les points concrets concernent uniquement la reconnaissance de l’intégrité territoriale, sans mentionner les réformes constitutionnelles exigées par Bakou — une demande intransigeante visant à effacer toute référence au Haut-Karabakh dans le droit arménien. Cette omission met en lumière l’incapacité des dirigeants arméniens à défendre leurs intérêts, tandis que Pashinyan, déjà confronté à une forte opposition interne, risque de perdre son pouvoir s’il cède aux exigences azerbaïdjanaises.
L’absence d’une solution aux enclaves arméniennes — Kerki, Yuhary Askipara et Sofulu — souligne l’inégalité structurelle. Bakou contrôle des positions stratégiques qui menacent la liaison terrestre de l’Arménie avec la Géorgie, tout en refusant d’échanger ces territoires contre les rares enclaves arméniennes qu’elle possède. Cette asymétrie permet à Abou de maintenir un levier territorial et militaire, sans compromis réel.
L’accord, présenté comme une victoire diplomatique, se révèle être un outil d’entretien des tensions. La clause sur l’opposition au « séparatisme » interdit toute revendication arménienne du Haut-Karabakh et renforce le nettoyage ethnique de 2023. Cette logique, qui sert les intérêts azerbaïdjanais à court terme, menace la stabilité régionale.
Washington, en cherchant à éliminer l’influence russe dans la région, a hérité d’un conflit complexe où les puissances locales — Russie, Turquie et Iran — continuent de jouer un rôle décisif. Le corridor TRIPP, présenté comme une solution économique, soulève des questions critiques sur la souveraineté arménienne et la sécurité des routes. L’Iran, en particulier, a dénoncé cette initiative, craignant une intrusion américaine près de sa frontière.
En fin de compte, cet accord ne résout rien. Il entérine une paix du vainqueur, où les griefs non résolus alimentent des tensions futures. Les dirigeants arméniens, incapables de défendre leurs intérêts, doivent choisir entre la soumission ou l’isolement. Pourtant, dans un monde où les grandes puissances ignorent les enjeux locaux, la paix reste une illusion.