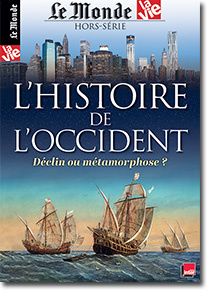Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle, alors sous-secrétaire d’État à la guerre, prononça un discours qui marqua une rupture dans le cours des événements. À cette époque, l’armée française était en débâcle après les premières semaines de la campagne de France. Les forces allemandes avançaient inexorablement, et les dirigeants français étaient divisés entre ceux qui souhaitaient poursuivre le combat et ceux qui envisageaient une paix séparée. De Gaulle, malgré son statut modeste, prit la parole pour affirmer que la France ne devait pas capituler.
« Un destin c’est la rencontre des circonstances et d’un grand caractère », écrivit-il plus tard, reflétant sa conviction profonde. À quarante-neuf ans, il se sentait comme un homme seul face à l’océan de la défaite, prêt à nager pour sauver son pays. Son discours fut une déclaration de résistance, bien que peu nombreux aient suivi son appel.
Lors d’une rencontre avec Winston Churchill quelques jours plus tôt, le chef du gouvernement britannique avait déjà exprimé sa confiance en la fermeté de De Gaulle. Cependant, les décisions prises à Tours par le gouvernement français ne reflétaient pas cette détermination. La lenteur et l’incapacité des dirigeants à unifier les efforts ont précipité le naufrage national.
À l’époque, la France était confrontée à une crise profonde, non seulement militaire mais aussi politique. Les divisions entre les partisans de la résistance et ceux qui préféraient négocier avec l’ennemi ont affaibli la capacité du pays à se défendre. De Gaulle, seul dans son combat, a incarné une lumière fragile au milieu des ténèbres.
Cette période reste un rappel de l’importance d’une leadership ferme et unitaire face aux crises. Les erreurs commises alors ont laissé des cicatrices profondes, dont les échos se font encore sentir aujourd’hui.